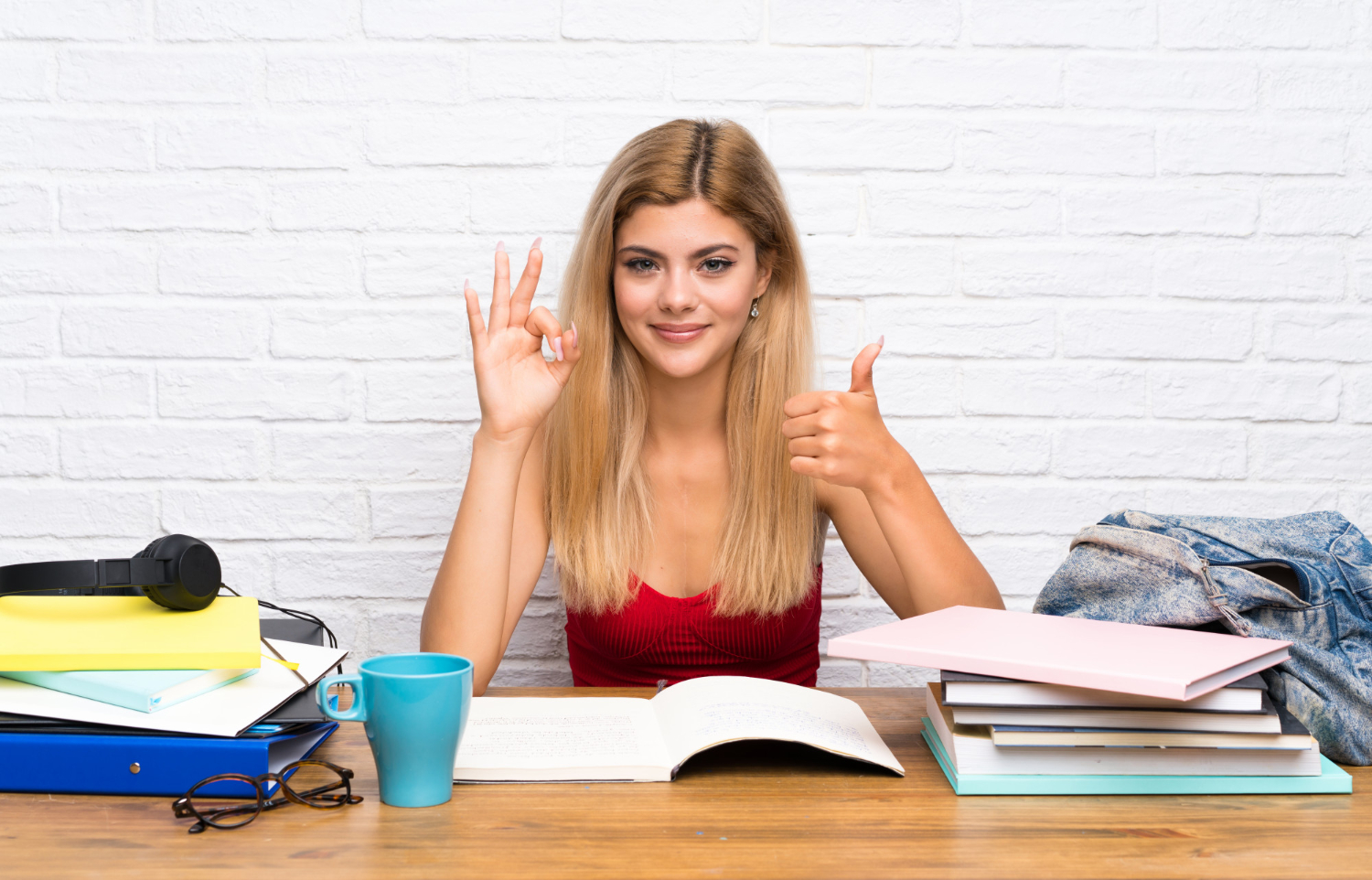L’importance de l’introduction dans un document de recherche
L’introduction est l’une des sections clés d’un document de recherche, car c’est la première impression que les examinateurs et les lecteurs se font de la recherche et qu’ils en évaluent la pertinence et l’importance scientifique. Dans cette section, vous pouvez découvrir le sujet de la recherche, ce qui a motivé l’auteur à poursuivre le sujet et pourquoi il est important. L’introduction fournit également des informations générales et aide à placer l’étude dans son contexte, en guidant les lecteurs dans le reste du manuscrit et en leur donnant une idée de la profondeur et de l’objectif du travail.
La rédaction d’une introduction de qualité peut s’avérer une tâche ardue. Pour ne rien oublier, les auteurs préfèrent souvent la rédiger à la fin de la préparation de l’article, lorsqu’ils ont déjà une idée claire de la structure et du contenu de l’ensemble du document. Les trois conseils suivants aideront les auteurs à créer une introduction convaincante et informative.
Conseil n° 1 : définir le contexte et expliquer l’importance de l’article
Pour commencer, le sujet de la recherche doit être brièvement présenté. Les auteurs doivent expliquer pourquoi leur travail est pertinent et comment il fait progresser les connaissances actuelles dans le domaine. L’objectif de l’introduction est d’intéresser les évaluateurs, les rédacteurs et les lecteurs en présentant le sujet de manière claire et convaincante.
Pour ce faire, il est utile d’inclure une brève revue de la littérature pertinente. Elle doit être suffisamment accessible à un large public et souligner la nécessité de l’étude. Il convient d’éviter les informations redondantes et de se concentrer sur les faits qui renforcent l’importance du sujet.
Des expressions telles que « récemment », « au cours des dix dernières années » ou « depuis la découverte de… » permettent d’ancrer le contexte dans le temps. Il est également utile de préciser le domaine de recherche : par exemple, « dans le domaine biomédical,… » ou « les polymères conducteurs ont fait l’objet d’une grande attention parce que… ».
La description du problème de recherche doit être aussi claire que possible. Commencez par la situation actuelle, puis indiquez ce que vous voulez changer, étudier ou améliorer. Des mots tels que « mais », « cependant » ou « malheureusement » aideront à souligner le contraste entre la situation actuelle et vos objectifs.
Pour exprimer clairement les objectifs de la recherche, il est utile de combiner en une seule phrase la description du problème et ce qui a été fait pour le résoudre. Les verbes suivants peuvent être utilisés pour décrire l’avancement de la recherche : enquêter, étudier, mesurer, développer, analyser, modéliser, etc. Voici un exemple :
« Le matériau A a fait l’objet d’une grande attention ces dernières années en raison de ses propriétés optiques. Cependant, sa faible stabilité a limité son utilisation à grande échelle. Pour résoudre ce problème, nous avons conçu un … »
Une bonne introduction doit également préparer le lecteur à la structure de l’article et définir ses attentes. Exemples de phrases :
- « Cet article traite de l’importance de… »
- « Ce manuscrit résume nos résultats sur… »
- « Cette communication décrit le mécanisme par lequel… »
- « Ce document rend compte de… »
Conseil n° 2 : utiliser le bon style et le bon temps grammatical
Le choix du bon temps grammatical dans les textes scientifiques permet de refléter avec précision la nature de l’information : faits établis, recherches achevées ou questions non résolues. Cela renforce la clarté et la crédibilité des données présentées.
Les auteurs doivent utiliser un style de présentation formel et impersonnel. Lorsqu’il s’agit de faits reconnus ou de vérités immuables, le présent simple est utilisé :
« L’or est un métal noble… »
Pour décrire des résultats spécifiques ou des situations temporelles, le passé simple est utilisé, avec une référence obligatoire à la source :
« Dans cette étude[1], l’or a catalysé la réaction… »
Dans certains cas, il convient d’utiliser le présent de l’indicatif, notamment lorsqu’il s’agit de problèmes qui n’ont pas encore été résolus :
« Bien que les propriétés du matériau soient bien connues, peu d’attention a été accordée à… »
« Le mécanisme exact n’a pas encore été signalé… »
Conseil n° 3 : Veillez à ce que votre introduction soit structurée et logique
Une introduction se compose généralement d’un à quatre paragraphes. Toutefois, s’il est nécessaire d’expliquer plus en détail des concepts ou des développements actuels dans le domaine, une section supplémentaire – « Contexte » ou « État de la technique » – peut être ajoutée.
Il est important de suivre une structure logique. Des références bibliographiques doivent être incluses afin que le lecteur comprenne la motivation des auteurs. Cela peut se faire de plusieurs manières :
- chronologiquement ;
- par groupes de théories, d’approches ou de modèles ;
- du général au spécifique.
Pour une meilleure structure, l’introduction peut être divisée en quatre parties :
- Justification de l’importance du sujet.
- Une vue d’ensemble des recherches antérieures et/ou actuelles.
- Formulation du problème et de l’approche choisie.
- Une brève description du contenu du document.
Pour savoir comment rédiger une section Méthodes efficace, consultez le matériel correspondant sur notre site web.