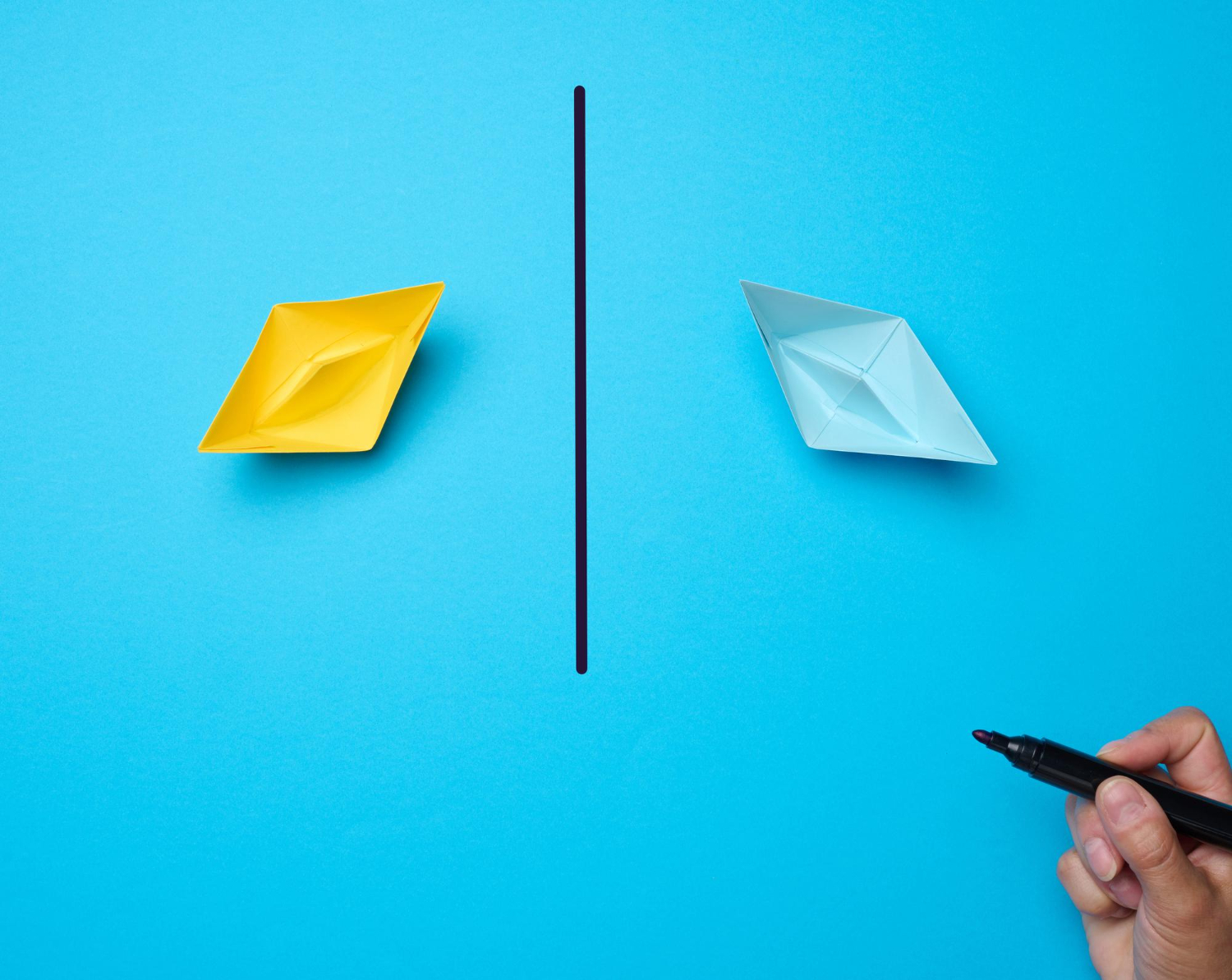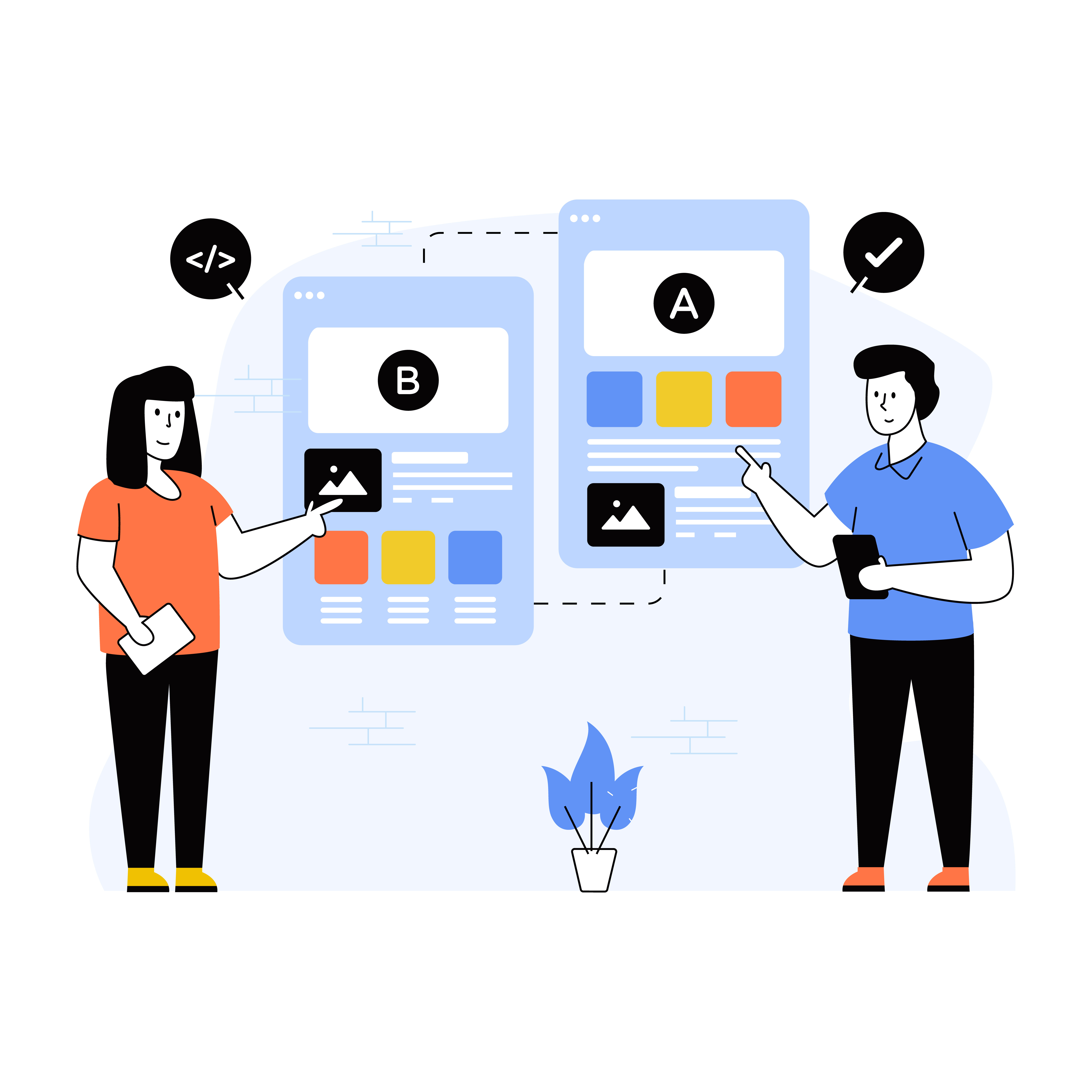Ross, un jeune chercheur, prépare un article scientifique en vue de sa publication. Après avoir rédigé le résumé, il passe à l’introduction, mais se sent désorienté : ces sections sont-elles interchangeables ? En quoi sont-elles différentes ? C’est une question qui préoccupe beaucoup d’auteurs débutants. Bien que le résumé et l’introduction puissent sembler similaires, ils remplissent des tâches différentes. Une section présente brièvement le travail, tandis que l’autre établit le contexte scientifique et justifie la recherche menée.
Qu’est-ce qu’un résumé ?
Un résumé est une description concise de la recherche, qui aide le lecteur à comprendre rapidement l’essence de l’article sans avoir à le lire en entier. Un résumé est particulièrement important pour les articles dont l’accès est limité : il aide à décider s’il vaut la peine de se référer au texte intégral.
Un bon résumé commence par une déclaration d’intention ou une brève description du problème de recherche. Il est suivi d’un exposé concis des méthodes, des principaux résultats et des conclusions. Le résumé ne fait pas référence à des sources et n’entre pas dans les détails. En règle générale, son volume ne dépasse pas 200 à 250 mots. Il doit être assez informatif sans être surchargé.
Il existe deux formats de résumé : structuré et non structuré. Le premier est divisé en parties logiques – objectif, méthodes, résultats, conclusions – et est le plus souvent utilisé dans les publications scientifiques. Le second est un paragraphe entier qui résume les principaux aspects de la recherche. Ce format est typique des disciplines des sciences humaines.
Lors de la rédaction d’un résumé, il est nécessaire de s’orienter vers les exigences d’une revue particulière. Cela s’applique à la fois à la structure et au style, ainsi qu’à la longueur autorisée. Le résumé n’est pas un compte rendu de l’ensemble de l’article, mais une brève déclaration autonome de l’article, permettant au lecteur de s’orienter rapidement dans le sujet.
Qu’est-ce que l’introduction ?
L’introduction ouvre la partie principale de l’article et sert à justifier la pertinence de la recherche. Elle ne reprend pas le résumé et ne contient pas de détails sur les résultats et les méthodes. Elle a pour but de familiariser le lecteur avec la problématique, les contradictions et les lacunes existantes dans la littérature, ainsi que d’exposer l’hypothèse ou les objectifs de l’étude.
L’introduction peut être rédigée après la rédaction du texte principal, ce qui permet de formuler avec précision les objectifs et de souligner l’importance des résultats. Les références aux sources qui confirment la validité scientifique de l’étude et la pertinence du problème soulevé constituent un élément obligatoire de l’introduction.
L’introduction est conçue dans un style formel, rédigée au présent et se compose généralement de plusieurs paragraphes. Sa structure comprend l’énoncé du problème, l’examen des recherches existantes, l’identification de la « niche » scientifique et la formulation des objectifs. L’introduction donne ainsi le ton à l’ensemble de l’article, en assurant une transition logique vers les méthodes et les résultats.
Il est essentiel de comprendre la différence entre un résumé et une introduction lors de la préparation d’un article de recherche. Le résumé est un bref point de référence, une sorte de « vitrine » de la recherche, tandis que l’introduction est une introduction raisonnée qui révèle le contexte scientifique et l’importance de l’article.
Si vous éprouvez des difficultés à rédiger ces sections, prêtez attention à la structure et à la fonction de chacune d’entre elles. Une bonne compréhension de leurs différences contribuera à rendre votre document plus convaincant et à le rendre plus facile et plus profond à lire.